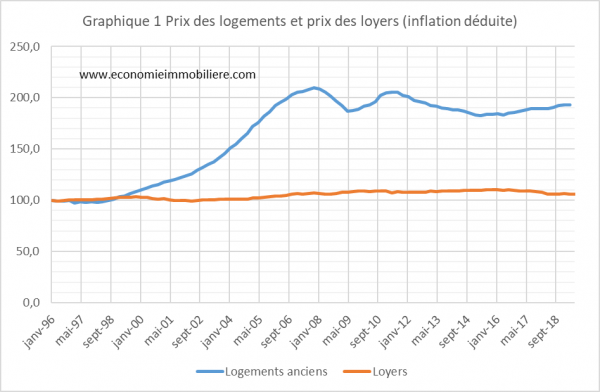Face au déficit du budget et à l’ampleur de la dette publique, la question de la taxation des patrimoines revient à l’ordre du jour. La théorie économique ne dit rien sur la fiscalité si ce n’est d’énoncer le principe de fiscalité optimale. Ce principe recommande d’éviter de taxer les grandeurs économiques qui modifieraient les comportements de consommation et d’investissement. Il faut donc privilégier la taxation des revenus et des patrimoines.
Marché du logement et aides publiques

Catégories
- Aides à la personne
- Allemagne
- Conditions de logement
- Construction
- Financement du logement
- Grèce
- HLM
- Immobilier et économie
- Immobilier et société
- inégalités
- Logements vacants
- Marchés immobiliers
- Non classé
- Politiques du logement
- Prix des logements
- Professions de l'immobilier
- Ukraine
- Vacance des logements
-
Articles récents
Commentaires récents
- didier cornuel dans Ouvrage : Economie immobilière et des politiques du logement
- KOFFI KOUADIO dans Ouvrage : Economie immobilière et des politiques du logement
- Quelle crise du logement ? | Economie immobilière dans Effets d’une relance de la construction sur l’économie et l’emploi
- sebastien dans Mon nouvel ouvrage : « Inégalités et Croissance, une contre analyse »
- Elias dans Combien va coûter le confinement ?
Archives